OCTOBRE 2016 | PAR FABIEN ESCALONA
La réélection de Corbyn prouve que son arrivée à la tête du Labour n’était pas un accident. Elle est révélatrice de la lutte violente qui se joue en son sein. Déjà, cette victoire interne incite certains responsables politiques et intellectuels, pas forcément proches de Corbyn, à repenser radicalement la social-démocratie. Et si celle-ci redevenait un champ de bataille intéressant ?
Le propre des moments de crises et de tournants historiques n’est pas seulement de donner à voir des affrontements sévères entre les acteurs qui cherchent à faire prévaloir leurs intérêts et convictions dans le passage d’un ordre ancien à un ordre nouveau. En général, ces moments se caractérisent aussi par une imprévisibilité plus forte de l’issue des rapports de force, en tout cas en comparaison des périodes plus ordinaires et routinières. Le partage convenu entre les analyses les plus sérieuses et les anticipations les plus farfelues peut alors être déjoué.
Prenons les diagnostics différents formulés à quelques décennies d’écart par deux dirigeants importants du Parti travailliste, Tony Benn (le mentor de Jeremy Corbyn) etDenis Healey. Disparus respectivement en 2014 et 2015, tous deux appartenaient à une génération née dans le premier quart du siècle dernier, et se sont régulièrement affrontés sur l’orientation de leur parti. Ce fut notamment le cas en 1981, lors d’une compétition pour le poste de numéro 2 du Labour. Healey, le chancelier de l’Échiquier qui avait combattu l’inflation au moyen du contrôle des salaires et poussé à la supervision de l’économie britannique par le FMI, s’était vu défié par Benn, figure de l’aile gauche et promoteur d’une démocratisation radicale de l’appareil partisan et de la société tout entière.
À cette époque, ce dernier n’hésitait pas à écrire que son parti était « trop ancré dans la classe ouvrière et dans l’idéologie socialiste pour être diverti de sa tâche historique de transformation de la société ». Il y a encore deux ans, cette confiance apparaissait rétrospectivement bien mal placée, et son pronostic définitivement obsolète, démenti qu’il était par l’évolution accomplie par le Parti travailliste entre-temps, depuis la défaite de Benn face à Healey jusqu’à la victoire durable des modernisateurs derrière Tony Blair. En revanche, le sobre constat lâché par Healey en 2010, selon lequel « il n’y avait plus de véritable aile gauche dans le Labour », semblait frappé du sceau de l’évidence.
Après tout, lors du scrutin interne de 2010 pour élire le nouveau leader du parti, la représentante la plus à gauche, Diane Abbott, n’avait récolté que 7,4 % des premières préférences du corps électoral (ce dernier étant encore divisé entre trois collèges de poids égal : les parlementaires, les adhérents directs, et les adhérents affiliés, via les syndicats essentiellement). Ed Miliband, qui avait battu de justesse son propre frère David au dernier tour de scrutin, ne pouvait être classé à la gauche de ce dernier que dans la mesure où il formulait une critique interne au projet de modernisation du Labour. De plus, il n’avait dû sa victoire qu’aux syndicats, ayant été nettement devancé parmi les adhérents individuels du parti.
Une nouvelle « phase critique » du parti
Tout a changé depuis l’élection surprise de Corbyn en août 2015. Et sa réélection le 24 septembre dernier atteste qu’il ne s’agissait pas d’un accident, favorisé par l’égarement de supporteurs incapables de raisonner, ainsi que l’avait suggéré Blair. Le leader travailliste a en effet réalisé un score légèrement supérieur à celui atteint l’an dernier, et en progression de dix points auprès des adhérents travaillistes. Parmi ceux-ci, il a conservé les neuf dixièmes de ses soutiens de 2015, et a attiré à lui un quart de ceux qui avaient voté pour Andy Burnham (plutôt situé au centre-gauche du parti).
Le fait que Blair s’inquiète désormais ouvertement de la possible obsolescence de sa stratégie centriste dans le paysage politique européen, constitue un indice supplémentaire qu’une phase historique est bien en train de s’ouvrir. Plusieurs éléments indiquent en effet que l’élection de Corbyn a déclenché une reconfiguration conflictuelle du Labour, qui pourrait s’avérer tout aussi cruciale que celle du début des années 1980, lorsque l’aile gauche avait tenté de prendre durablement le contrôle du parti et d’en faire le véhicule d’un projet authentiquement socialiste.
Un des points communs réside dans le « retournement » d’une caractéristique organisationnelle en faveur du camp jusque-là minoritaire. Il y a trente-cinq ans, alors que les syndicats étaient une pièce maîtresse du contrôle exercé par les élites travaillistes les plus modérées sur le parti, leur glissement à gauche sous la pression de leurs adhérents avait bouleversé les rapports de force internes. Cette fois-ci, c’est le mécanisme de primaire ouverte, conçu par les modernisateurs comme un moyen de diluer l’influence des responsables et des activistes les plus « archaïques », qui aura favorisé l’ascension de l’un d’entre eux à la tête du parti. Il s’agit-là d’un bel exemple d’« effet contre-intuitif », typique des situations de crise structurelle, lorsque des mécanismes assurant la permanence de la routine se révèlent soudain déstabilisateurs.
Tout aussi frappant est le degré de violence atteint par l’affrontement entre les pro et les anti-Corbyn. Visible à travers les échanges verbaux (le point Godwin a été atteint plusieurs fois), il est surtout repérable dans la guérilla d’interprétation que se livrent les deux camps à propos des règles et statuts du parti, au point que la justice a été saisie plusieurs fois. De fait, les parlementaires auront tout fait pour faire craquer Corbyn : organiser des démissions en cascade du cabinet fantôme, le défier lors d’une nouvelle primaire, tenter de l’empêcher d’y prendre part, limiter le collège électoral pour en écarter les adhérents les plus récents… Et le feuilleton continue, puisque l’appareil dispose encore de multiples procédures pour gêner Corbyn et ses proches. La dernière d’entre elles a consisté à laisser toute discrétion aux dirigeants des branches écossaise et galloise du parti pour choisir leur représentant au Bureau national, ce qui a suffi pour empêcher une majoritéclairement pro-Corbyn de s’y former.
Une lutte pour la redéfinition des fins poursuivies par le parti
Angelo PanebiancoEn réalité, les deux victoires successives de Corbyn ont révélé et accéléré « une décomposition de la “coalition dominante” » du Labour, un terme utilisé par le politiste italien Angelo Panebianco. D’après lui, le contrôle d’un parti, même très personnalisé en apparence, repose toujours sur une pluralité d’acteurs détenant une parcelle plus ou moins grande de pouvoir interne. Le degré de cohésion et de stabilité de la coalition dominante, ainsi que les canaux par lesquels elle exerce son autorité, dessinent ensemble l’« ordre organisationnel » du parti.
Si l’élection de Miliband en 2010 avait déjà témoigné d’un changement de rapports de force internes entre les groupes de la coalition dominante modernisatrice, l’élection de Corbyn en 2015 l’a encore davantage mise à l’épreuve. Privée de la tête du parti, lâchée par des syndicats importants, elle a vu la prédominance des parlementaires être contestée au nom de la démocratie interne, et a fort mal caché ses divisions derrière la fade candidature d’Owen Smith, le challenger de Corbyn.
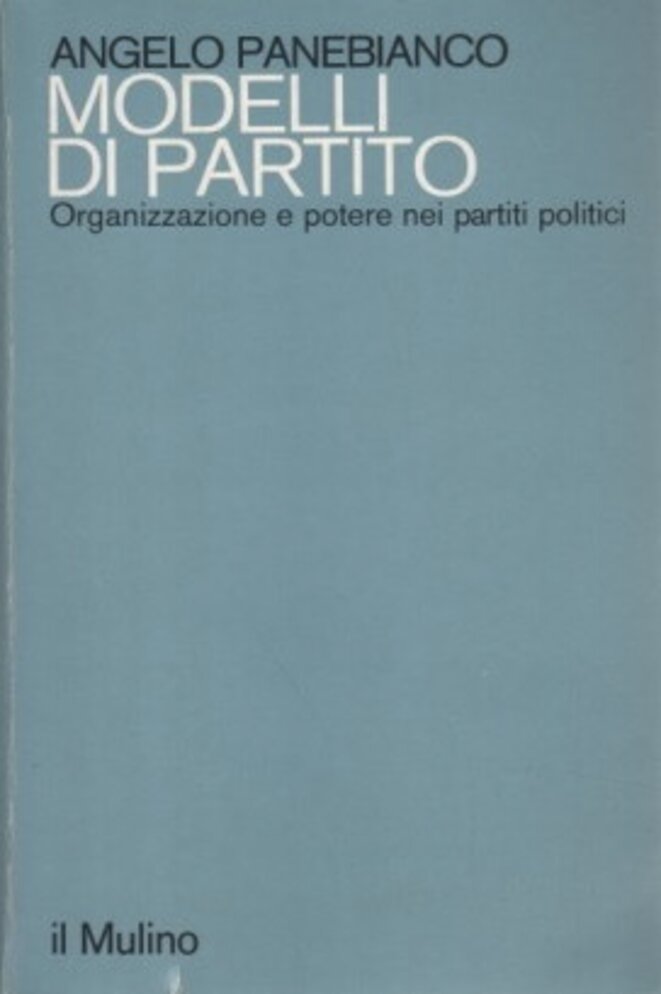
La réélection de Corbyn prouve que son arrivée à la tête du Labour n’était pas un accident. Elle est révélatrice de la lutte violente qui se joue en son sein. Déjà, cette victoire interne incite certains responsables politiques et intellectuels, pas forcément proches de Corbyn, à repenser radicalement la social-démocratie. Et si celle-ci redevenait un champ de bataille intéressant ?
Le propre des moments de crises et de tournants historiques n’est pas seulement de donner à voir des affrontements sévères entre les acteurs qui cherchent à faire prévaloir leurs intérêts et convictions dans le passage d’un ordre ancien à un ordre nouveau. En général, ces moments se caractérisent aussi par une imprévisibilité plus forte de l’issue des rapports de force, en tout cas en comparaison des périodes plus ordinaires et routinières. Le partage convenu entre les analyses les plus sérieuses et les anticipations les plus farfelues peut alors être déjoué.
Prenons les diagnostics différents formulés à quelques décennies d’écart par deux dirigeants importants du Parti travailliste, Tony Benn (le mentor de Jeremy Corbyn) etDenis Healey. Disparus respectivement en 2014 et 2015, tous deux appartenaient à une génération née dans le premier quart du siècle dernier, et se sont régulièrement affrontés sur l’orientation de leur parti. Ce fut notamment le cas en 1981, lors d’une compétition pour le poste de numéro 2 du Labour. Healey, le chancelier de l’Échiquier qui avait combattu l’inflation au moyen du contrôle des salaires et poussé à la supervision de l’économie britannique par le FMI, s’était vu défié par Benn, figure de l’aile gauche et promoteur d’une démocratisation radicale de l’appareil partisan et de la société tout entière.
À cette époque, ce dernier n’hésitait pas à écrire que son parti était « trop ancré dans la classe ouvrière et dans l’idéologie socialiste pour être diverti de sa tâche historique de transformation de la société ». Il y a encore deux ans, cette confiance apparaissait rétrospectivement bien mal placée, et son pronostic définitivement obsolète, démenti qu’il était par l’évolution accomplie par le Parti travailliste entre-temps, depuis la défaite de Benn face à Healey jusqu’à la victoire durable des modernisateurs derrière Tony Blair. En revanche, le sobre constat lâché par Healey en 2010, selon lequel « il n’y avait plus de véritable aile gauche dans le Labour », semblait frappé du sceau de l’évidence.
Après tout, lors du scrutin interne de 2010 pour élire le nouveau leader du parti, la représentante la plus à gauche, Diane Abbott, n’avait récolté que 7,4 % des premières préférences du corps électoral (ce dernier étant encore divisé entre trois collèges de poids égal : les parlementaires, les adhérents directs, et les adhérents affiliés, via les syndicats essentiellement). Ed Miliband, qui avait battu de justesse son propre frère David au dernier tour de scrutin, ne pouvait être classé à la gauche de ce dernier que dans la mesure où il formulait une critique interne au projet de modernisation du Labour. De plus, il n’avait dû sa victoire qu’aux syndicats, ayant été nettement devancé parmi les adhérents individuels du parti.
Une nouvelle « phase critique » du parti
Tout a changé depuis l’élection surprise de Corbyn en août 2015. Et sa réélection le 24 septembre dernier atteste qu’il ne s’agissait pas d’un accident, favorisé par l’égarement de supporteurs incapables de raisonner, ainsi que l’avait suggéré Blair. Le leader travailliste a en effet réalisé un score légèrement supérieur à celui atteint l’an dernier, et en progression de dix points auprès des adhérents travaillistes. Parmi ceux-ci, il a conservé les neuf dixièmes de ses soutiens de 2015, et a attiré à lui un quart de ceux qui avaient voté pour Andy Burnham (plutôt situé au centre-gauche du parti).
Le fait que Blair s’inquiète désormais ouvertement de la possible obsolescence de sa stratégie centriste dans le paysage politique européen, constitue un indice supplémentaire qu’une phase historique est bien en train de s’ouvrir. Plusieurs éléments indiquent en effet que l’élection de Corbyn a déclenché une reconfiguration conflictuelle du Labour, qui pourrait s’avérer tout aussi cruciale que celle du début des années 1980, lorsque l’aile gauche avait tenté de prendre durablement le contrôle du parti et d’en faire le véhicule d’un projet authentiquement socialiste.
Un des points communs réside dans le « retournement » d’une caractéristique organisationnelle en faveur du camp jusque-là minoritaire. Il y a trente-cinq ans, alors que les syndicats étaient une pièce maîtresse du contrôle exercé par les élites travaillistes les plus modérées sur le parti, leur glissement à gauche sous la pression de leurs adhérents avait bouleversé les rapports de force internes. Cette fois-ci, c’est le mécanisme de primaire ouverte, conçu par les modernisateurs comme un moyen de diluer l’influence des responsables et des activistes les plus « archaïques », qui aura favorisé l’ascension de l’un d’entre eux à la tête du parti. Il s’agit-là d’un bel exemple d’« effet contre-intuitif », typique des situations de crise structurelle, lorsque des mécanismes assurant la permanence de la routine se révèlent soudain déstabilisateurs.
Tout aussi frappant est le degré de violence atteint par l’affrontement entre les pro et les anti-Corbyn. Visible à travers les échanges verbaux (le point Godwin a été atteint plusieurs fois), il est surtout repérable dans la guérilla d’interprétation que se livrent les deux camps à propos des règles et statuts du parti, au point que la justice a été saisie plusieurs fois. De fait, les parlementaires auront tout fait pour faire craquer Corbyn : organiser des démissions en cascade du cabinet fantôme, le défier lors d’une nouvelle primaire, tenter de l’empêcher d’y prendre part, limiter le collège électoral pour en écarter les adhérents les plus récents… Et le feuilleton continue, puisque l’appareil dispose encore de multiples procédures pour gêner Corbyn et ses proches. La dernière d’entre elles a consisté à laisser toute discrétion aux dirigeants des branches écossaise et galloise du parti pour choisir leur représentant au Bureau national, ce qui a suffi pour empêcher une majoritéclairement pro-Corbyn de s’y former.
Une lutte pour la redéfinition des fins poursuivies par le parti
Angelo PanebiancoEn réalité, les deux victoires successives de Corbyn ont révélé et accéléré « une décomposition de la “coalition dominante” » du Labour, un terme utilisé par le politiste italien Angelo Panebianco. D’après lui, le contrôle d’un parti, même très personnalisé en apparence, repose toujours sur une pluralité d’acteurs détenant une parcelle plus ou moins grande de pouvoir interne. Le degré de cohésion et de stabilité de la coalition dominante, ainsi que les canaux par lesquels elle exerce son autorité, dessinent ensemble l’« ordre organisationnel » du parti.
Si l’élection de Miliband en 2010 avait déjà témoigné d’un changement de rapports de force internes entre les groupes de la coalition dominante modernisatrice, l’élection de Corbyn en 2015 l’a encore davantage mise à l’épreuve. Privée de la tête du parti, lâchée par des syndicats importants, elle a vu la prédominance des parlementaires être contestée au nom de la démocratie interne, et a fort mal caché ses divisions derrière la fade candidature d’Owen Smith, le challenger de Corbyn.
Ce à quoi l’on assiste actuellement est donc l’incapacité de la coalition dominante héritée du New Labour de Tony Blair à reproduire sa légitimité et à nouer des compromis sauvegardant son contrôle de l’appareil. Pis, elle se voit contestée par une autre coalition prétendant à ce contrôle, bâtie sur le soutien des adhérents, d’une bonne part des syndicats et d’une faction externe baptisée « Momentum ». Les exclus d’hier sont désormais « dans la place », faisant vivre à l’aile la plus droitière du parti une expérience digne de la série Trepalium, lorsqu’ils se voient envahis par les « zonards ». Or, nous dit Panebianco dans son ouvrage de 1982, un changement d’identité de la coalition dominante est propice à un changement des règles pour assurer sa longévité, ainsi qu’à un changement des « fins du parti », c’est-à-dire le projet qu’il défend et la stratégie qu’il entend mettre en œuvre pour le réaliser.
Sa grille de lecture semble d’autant plus appropriée à la situation actuelle des travaillistes, que la nouvelle direction souhaite justement pousser ses pions pour donner davantage de poids aux adhérents, et contourner voire transformer ainsi le groupe parlementaire et les organes qui ne lui sont pas favorables. Elle doit néanmoins agir avec prudence pour ne pas risquer de scission, et surtout éviter de perdre le soutien de grands syndicats, si jamais ceux-ci voyaient également leurs prérogatives entamées.
Les camps en présence portent bien des visions irréconciliables du parti. L’essentiel des parlementaires, tenant à leur autonomie et outrés que des comptes puissent être demandés à la classe politique professionnalisée qu’ils ont intégrée, compte poursuivre une stratégie d’adaptation aux conceptions apparemment dominantes sur l’économie ou l’immigration. Les partisans de Corbyn, de leur côté, conçoivent davantage le parti comme un mouvement social, dont la capacité de transformation de la société et des consciences est au moins aussi importante que la capacité à conquérir des charges électives. Ils refusent par ailleurs que la démocratie puisse être réduite au mécanisme de la délégation.
Cela apparaît très clairement dans les premières enquêtes menées auprès des membres du parti les plus récents, ayant adhéré après l’élection générale de 2015. La chercheuse Monica Poletti a ainsi montré que ceux-ci sont bien plus critiques de la classe politique en général que les adhérents plus anciens. Les premiers sont également plus nombreux que les seconds à juger qu’un bon leader doit être à l’écoute des citoyens et défendre ses convictions, et moins nombreux à penser que sa priorité doit être la séduction de « l’électeur moyen ». Interrogés par l’institut YouGov sur le fait d’obliger les députés sortants à être réinvestis par les militants de leur circonscription, les adhérents travaillistes ont donné des réponses qui ne pouvaient être plus contrastées : alors que les partisans de Corbyn approuvaient l’idée à près de 70 %, les partisans de Smith (son challenger) la réprouvaient à près de 80 %.
Si l’exception britannique n’est pas dans le rejet de la classe politique, ni dans le désir d’une transformation sociale accomplie avec l’implication réelle des citoyens, se retrouve-t-elle dans le fait que cette contestation s’exprime par la voie d’un grand parti de centre-gauche ? Ici, le degré d’ouverture de la compétition politique joue à plein. Le mode de scrutin britannique est impitoyable pour les tiers partis. Dans ce contexte, la primaire interne a été un outil de déverrouillage inespéré. Même si le succès n’a pas été aussi éclatant, cette procédure a également été vitale pour la percée de Sanders aux États-Unis.
Ailleurs en Europe, il n’est pas illogique que des nouveaux partis ou des partis autrefois marginaux en aient davantage profité. Le dilemme du cas français est que la compétition politique est à la fois plus ouverte que dans les cas américain et britannique, et plus fermée que dans beaucoup d’autres États. Ajoutons que notre pays occupe également une position intermédiaire sur l’échelle de la gravité de la crise : pas aussi destructrice que dans la périphérie de la zone euro et les capitalismes les plus financiarisés, mais pas aussi contenue que dans certains pays exportateurs d’Europe du Nord. En tout état de cause, l’exemple britannique suggère qu’une primaire ne génère pas en tant que telle les effets délétères qui lui sont souvent reprochés (personnalisation, course au centre…). Pourvu que les modalités et le contexte soient favorables, des entrepreneurs politiques et des citoyens déterminés peuvent aussi s’en emparer pour déjouer le contrôle d’une coalition dominante.
Au-delà de l’espoir que les ailes gauches marginalisées peuvent trouver dans le Labour de Corbyn, l’exemple travailliste signale que les conséquences de la crise peuvent à nouveau faire de la social-démocratie un champ de bataille. La crise du parti socialiste espagnol, au caractère inédit depuis la transition postfranquiste, en atteste. Les phases conflictuelles prendront évidemment des contours différents selon les cas nationaux, mais pourraient donc s’ouvrir ailleurs qu’au Royaume-Uni.
Repenser la social-démocratie : un nouveau champ de bataille
À ce propos, notons qu’une des conséquences les plus intéressantes de la crise en cours peut s’observer dans les franges les plus réflexives de l’univers travailliste, là où les intérêts matériels à préserver obscurcissent moins la compréhension du défi posé par Corbyn. En particulier, plusieurs intellectuels appartenant historiquement à la soft left(la faction la plus modérée de l’aile gauche des années 1980) tentent de redéfinir ce que serait une social-démocratie du XXIe siècle, en phase avec les sociétés contemporaines mais échappant au fatalisme face à leurs tendances dominantes. Dans les années 1990, le hold-up intellectuel des blairistes avait en effet consisté à s’appuyer sur des analyses de la nouvelle ère post-fordiste, issues des cultural studies et des cercles eurocommunistes, pour mieux déployer une vision acritique de la globalisation capitaliste.
Selon lui, le salut passe par la défense de la proportionnelle et l’inclusion du Labour dans un vaste front ouvert aux partis et à la société civile, fonctionnant de manière horizontale et uni par la volonté de démocratiser tous les espaces de vie collective, sans se contenter de la seule voie électorale. À défaut, écrit-il, le Labour deviendra « un parti Kodak dans le monde d’Instagram ».Le président du groupe de réflexion Compass, Neal Lawson, a par exemple écrit cet été une lettre ouverte stimulante à son propre parti. Reprenant des réflexions publiées ailleurs, son texte témoigne d’une prise de conscience que toutes les précédentes configurations de la social-démocratie (celle de l’ère keynésienne mais aussi celle de l’ère néolibérale) sont désormais obsolètes. À la limite, Lawson trouverait presque Corbyn trop timoré dans sa stratégie, qu’il qualifie de « route parlementaire avec [seulement] un morceau d’activité extraparlementaire » en plus.
Assurément, la tâche est immense à accomplir pour rebâtir une offre travailliste rassembleuse, dans un pays durement frappé par la crise et dont les profondes fractures sociales et territoriales ont été mises en évidence lors des derniers scrutins. La situation du Labour est d’autant plus mouvante que les coalitions en compétition pour le contrôle du parti sont pétries de contradictions et/ou de divisions. Au-delà des spécificités britanniques, cependant, la séquence ouverte par les victoires de Corbyn témoigne bien de l’impératif de réinvention qui s’impose aux partis dominants de centre-gauche.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vos réactions nous intéressent…